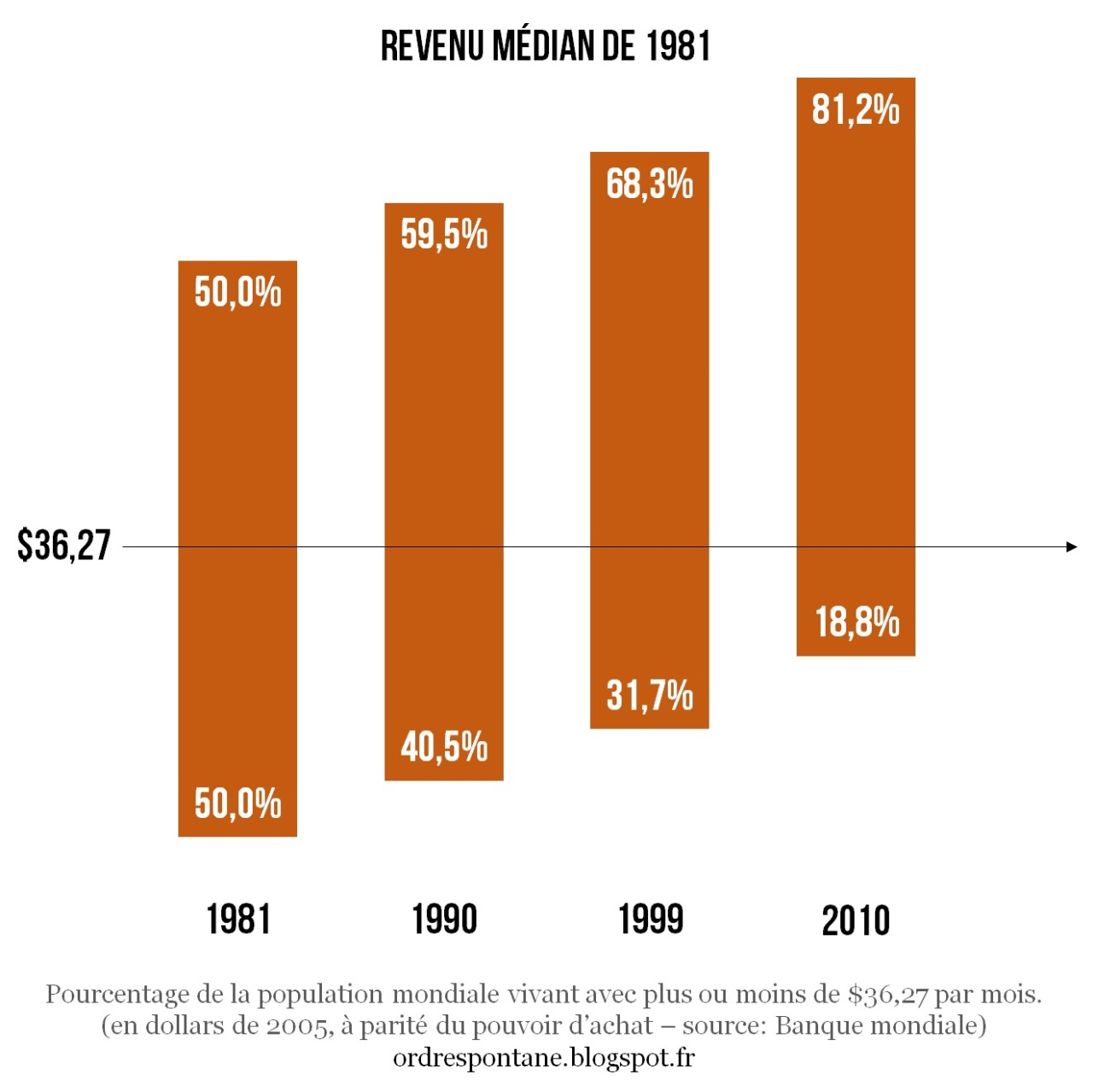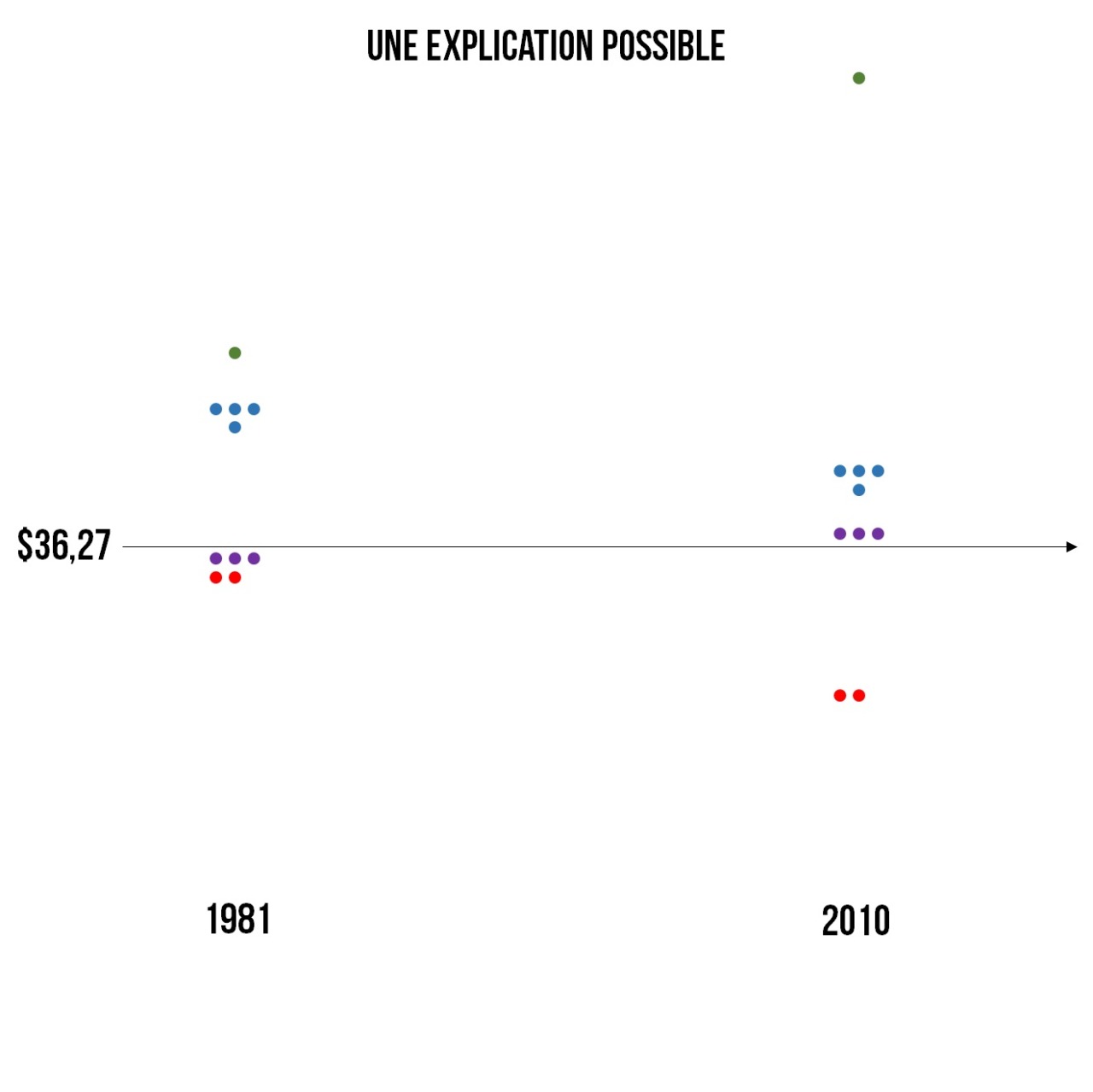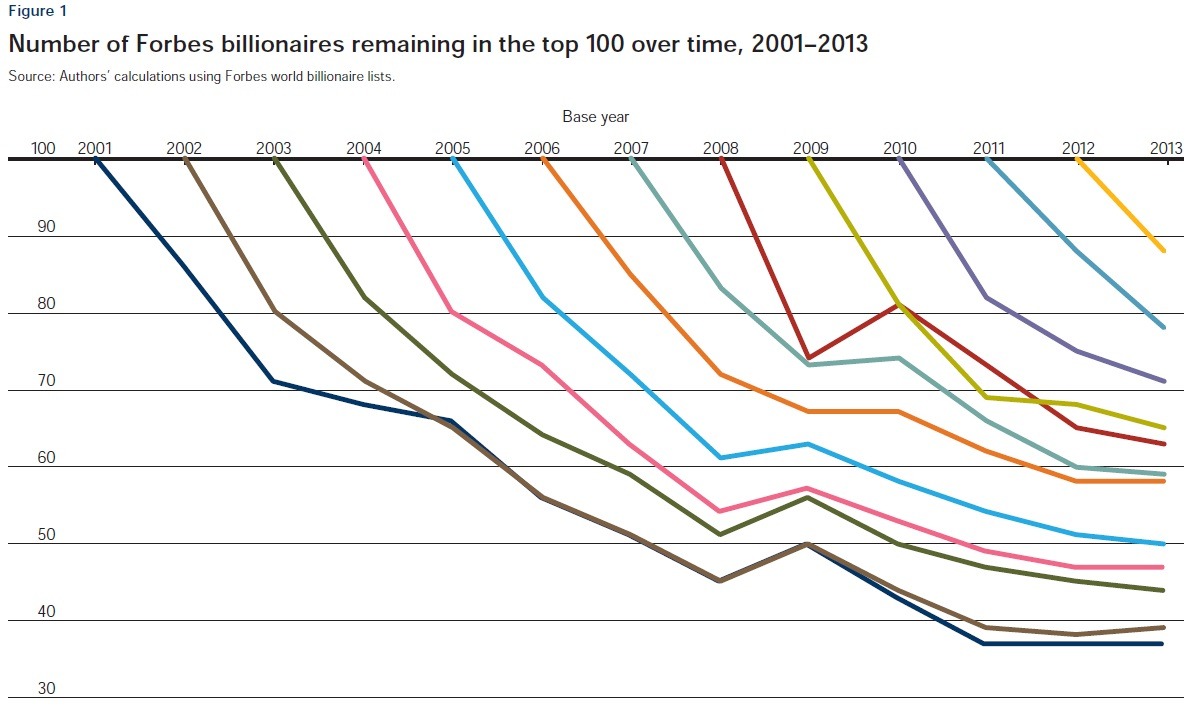Le président de la République a donc souhaité passer un pacte avec le patronat. En substance — au diable les détails — il est question d’alléger les charges qui pèsent sur le compte de résultat des entreprises en contrepartie de quoi ces dernières s’engageraient à embaucher.
Dans la réalité tout à fait concrète des choses, il va de soi que le président n’a pas couru nos vertes campagnes pour rencontrer, un à un, les millions d’entrepreneurs qu’il est convenu de désigner sous le terme générique de « patron ». Dans la plus pure tradition du corporatisme d’ancien régime, il a passé ce contrat avec les « partenaires sociaux » ; c’est-à-dire des organisations qui n’ont d’autre légitimité que celle d’avoir été désignés comme interlocuteurs légitimes du pouvoir par le pouvoir lui-même. En l’espèce, c’est du Medef qu’il s’agit ; une organisation dite « patronale » à peu près aussi représentative des entrepreneurs français que la CGT peut l’être des salariés de même nationalité.
C’est dire assez le sérieux de cette affaire.
On imagine d’ici ce que pensent ces milliers d’entrepreneurs, officiellement engagés par une parole qu’ils n’ont pas donné dans une aventure qui n’entretient avec leur réalité quotidienne qu’un rapport lointain — dans le meilleur des cas.
De deux choses l’une : soit le président a signé ce pacte de bonne foi, pensant avoir réellement affaire à patronat monolithique et à des organisations réellement représentatives, soit il se fiche ouvertement de notre poire en brassant de l’air pour tenter de s’envoler dans les sondages. Dans le premier cas, c’est un imbécile ; dans le second, c’est un démagogue. Au choix.
Bref, remettons ce pacte de pacotille à sa juste place et intéressons-nous, Ô lecteur, à l’effet qu’il est raisonnable d’attendre d’une baisse des charges — des impôts — qui pèsent sur les entreprises qui ont l’outrecuidance d’exploiter le lumpenprolétariat — i.e. d’embaucher des salariés.
Commençons par rappeler deux vérités essentielles.
Primo, les entreprises ne paient pas d’impôts — jamais, en aucune manière et pas un centime : ce sont partout et toujours des personnes physiques, faites de chair et de sang, qui paient l’impôt. Il peut peser sur les actionnaires, les créanciers, les salariés, les clients ou les fournisseurs d’une entreprise mais jamais sur l’entreprise elle-même. En l’occurrence, nous dit la théorie fiscale, ce sont les actionnaires — a.k.a. les « patrons » — qui sont supposés payer la facture des charges dites patronales ; en réalité, personne n’en sait rien et il est même assez vraisemblable que ce soient les salariés qui en supportent réellement la charge — soit qu’ils soient au chômage, soit qu’ils se fassent ponctionner plus de la moitié de leur salaire réel.
Deuxio, il existe une règle d’or, aussi fondamentale qu’elle est méconnue du législateur, qui dit que quel que soit le système que vous mettez en place, vous devez toujours partir du principe que celles et ceux auxquels il est supposé s’imposer l’exploiteront au mieux de leurs intérêts. Ce n’est pas du cynisme, c’est du réalisme : il faut être politicien de carrière et, de surcroît, en grande difficulté pour se payer de « patriotisme économique » ou de « responsabilité sociale ». Dans la réalité concrète, et même si certains arrivent à se convaincre du contraire, nous ne coopérons les uns avec les autres que lorsque nous y trouvons un intérêt clairement identifiable.
Forts de ce qui précède, demandons-nous comment réagira l’employeur lambda face à ce pacte de dupes. Il sait que, pour un temps au moins, l’état lui réclamera moins de charges ce qui lui donne — au moins — sept possibilités : rétablir ses marges pour se payer mieux, rétablir ses marges pour réinvestir, en faire bénéficier ses fournisseurs, augmenter ses salariés, baisser ses prix de vente, rembourser ses dettes et, enfin, si le besoin s’en fait sentir, embaucher de nouveaux salariés.
Or, dans un environnement où les marges des entreprises sont au plus bas, où les carnets de commandes se vident, où les taxes et les règlementations prolifèrent et où les salariés voient leur pouvoir d’achat fondre comme neige au soleil ; dans un tel environnement, disais-je, toutes les autres options semblent clairement préférables à l’embauche. Honnêtement, qui peut croire qu’une baisse sous conditions des prélèvements obligatoires soit de nature à redonner confiance à des entrepreneurs avec un Montebourg en liberté et un Front National en embuscade ?
Très clairement, la seule stratégie raisonnable aujourd’hui, c’est celle du passager clandestin : profiter de la baisse des charges tant qu’elle dure tout en évitant soigneusement de donner suite au pacte présidentiel. Même à supposer que vous ayez eu, ne serait-ce qu’un bref instant, envie de jouer le jeu, un bref détour par la théorie des jeux — une variante du dilemme du prisonnier — vous convaincra que vous avez toutes les chances d’être le dindon de la farce. Un tiens, dit le proverbe, vaut mieux que deux tu l’auras.
Les employeurs, pour peu qu’ils en aient les moyens, n’emploieront que lorsqu’ils seront convaincus d’avoir intérêt à le faire — c’est aussi bête que ça. De la même manière que la baisse planifiée des taux d’intérêt n’a pas incité les emprunteurs potentiels à s’endetter, une baisse du coût du travail ne fonctionnera que lorsque les employeurs potentiels auront de solides raisons de développer leurs activités. Baisser les charges aurait pu être une bonne idée si et seulement si cette mesure s’était insérée dans une démarche d’ensemble destinée à redonner confiance aux entrepreneurs : imposé du bout des lèvres par un gouvernement aux abois qui, il y a quelques semaines encore, ne jurait que par les vertus de la redistribution, de l’état-stratège et de la régulation à tout va, cet énième sparadrap n’a tout simplement aucune crédibilité et n’aura donc aucun effet.